Edito de Bernard Carayon
L’impératif industriel
Le colbertisme « high-tech » aurait vécu. Le modèle de dirigisme économique hérité du Général de Gaulle est ainsi désigné par les économistes Elie Cohen et Pierre-André Buigues, dans Le Décrochage industriel1. Elie Cohen regrette ainsi que la France ait abandonné ce modèle qui était « au cœur de sa stratégie industrielle sans le remplacer par rien. »
Il est certain qu’avec l’ouverture, même relative, de la France au commerce international dans les années 1980-90, il était difficile de maintenir la promotion de nos champions nationaux, passant par la commande publique « au service de la formation de champions nationaux, le protectionnisme offensif, les transferts de résultats de la recherche publique, les grands plans nationaux d’équipement, la connivence entre élites politiques, administratives, industrielles et de gestion. » Ces leviers d’action ont été perdus.
La commande publique ne peut plus être aussi massive que par le passé, en raison des déficits publics et de la monnaie unique européenne qui interdit de recourir unilatéralement à la création monétaire.
Le protectionnisme offensif est proscrit autant par le droit européen de la concurrence que par les règles de l’OMC.
Concernant les transferts des découvertes de la recherche publique vers les champions nationaux, quelque chose a dû se briser en cours de route. Pour preuve, les Présidents de la République Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy s’étaient sentis obligés de promouvoir les pôles de compétitivité où les centres de recherche, l’Etat et les entreprises sont réunis dans des projets partagés; cela démontre que les échanges de savoir entre les deux stagnaient et justifiaient une relance.
La France a renoncé aux grands plans nationaux d’équipement ; les outils administratifs ont été bazardés pour partie, comme le commissariat au Plan, dont Henri Guaino fut le dernier et brillant titulaire.
La connivence entre élites politiques, administratives, industrielles et de gestion n’a cessé d’être dénoncée – depuis les affaires Elf ou du Crédit lyonnais jusqu’aux accusations portées contre l’ancienne présidente d’Areva. Tous les ennemis du capitalisme stato-dirigé à la française ont trouvé là matière à sa dénonciation morale.
La critique des auteurs du Décrochage industriel n’est pas originale. Dès 1985, Michel Bauer décrivait la médiocrité de nos classes dirigeantes avec des hommes politiques « jouant au Monopoly » et des managers « se prenant pour Clausewitz ». Pire encore, Elie Cohen dénonça en 1989 l’ « Etat-brancardier » : les autorités publiques ont renoncé à l’industrie, et se contentent d’amortir les conséquences sociales de son déclin.
Pendant que les dirigeants français assurent une sorte de service après-vente, nos concurrents ont soutenu leur industrie nationale. Les machines et textiles italiens sont passés en trente ans du sixième au cinquième rang mondial, tandis que les français tombaient du cinquième au huitième rang. Les responsables politiques sont aussi complètement passés à côté des efforts de leurs pairs européens sur l’environnement et les économies d’énergie. En Europe, 27% des aides d’Etat sont consacrés à ces activités, mais 40% en Allemagne, 65% aux Pays-Bas, 86% en Suède, 41% au Royaume-Uni. La France n’y investit que 2% de ses aides publiques ! Et si les Allemands vendent difficilement leurs panneaux solaires face aux Chinois, ces derniers achètent à Berlin les machines-outils pour construire leurs propres panneaux !
Plusieurs secteurs industriels sont profondément pénalisés de ces aberrations hexagonales. La filière nucléaire a surestimé ses chances d’exporter son savoir-faire à l’étranger, en oubliant le facteur-coût qui s’avère dissuasif ; sur les dix tranches d’EPR programmées d’ici à 2016, seules quatre sont en construction. Les réponses des prospects chinois et indiens se font attendre, et l’engagement des Saoudiens n’est pas encore acquis. Le ferroviaire est lui aussi en déclin : les marges de la SNCF se sont effondrées de 60% depuis 2000. Notre TGV se fait maintenant concurrencer par ses équivalents espagnols et coréens ; il risque à l’avenir la concurrence du TGV chinois. L’agroalimentaire reste en apparence une source de fierté pour la France, avec un solde net de 9,5 milliards d’euros qui en fait le deuxième poste excédentaire de la balance commerciale, derrière l’aéronautique. Mais, plusieurs de ses secteurs sont en crise structurelle, comme les élevages de porc ou de volaille qui souffrent de la concurrence internationale. Grâce à des économies d’échelle et à de moindres coûts salariaux, des pays comme les Etats-Unis, le Brésil ou l’Allemagne sont passés devant la France, la rétrogradant de sa deuxième place à la cinquième, en 2013. De même, le BTP français est passé de 19,4% à 13,8% de part mondiale entre 1999 et 2012. Dans le même temps, la part du BTP chinois a triplé pour passer à 13,6%, les grands cabinets d’ingénierie anglo-saxons ne recourant plus systématiquement aux entreprises françaises. Même les grands groupes, tels Veolia et Suez, ont dorénavant du mal à s’imposer dans
les appels d’offres. Seule l’aéronautique tire son épingle du jeu, Airbus s’étant imposé face à Boeing. Ce secteur contribue pour plus de vingt milliards d’euros par an au commerce extérieur de la France.
L’industrie française a atteint, selon l’expression de Louis Gallois, la « côte d’alerte », d’autant plus que la crise industrielle s’alimente toute seule : toute croissance de la consommation augmente la part des importations et dope le déficit commercial. L’impôt sur les ménages ayant atteint – visiblement – un plafond pour les autorités publiques, il ne reste plus que les entreprises pour dégager des marges fiscales nouvelles. Mais les recettes de l’impôt sur les sociétés diminuent elles-mêmes sous l’effet de la crise.
La désindustrialisation n’est pas prête de s’achever.
La puissance de la France et de ses entreprises face aux menaces numériques

Par Yves Roucaute, Professeur agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur d’État en sciences politiques et docteur en philosophie, Directeur du Master de Management du Risque à Paris-X Nanterre.
La France a-t-elle pris la mesure des défis de la mondialisation, liés à la révolution du numérique? Cela n’est pas certain. Il semble que structurellement, financièrement et humainement, le pays ne se soit pas doté d’une stratégie en mesure de protéger son territoire, ses entreprises, ses recherches et ses intérêts vitaux et, encore moins, de propulser sa puissance. Deuxième surface économique exclusive du monde avec 12 millions de Km2, troisième puissance militaire, cinquième puissance économique … la réaction politique est-elle donc à la hauteur des enjeux ?
Les cris d’orfraie poussés lors de la « découverte » des systèmes d’écoutes et de surveillances nord-américains comme le système « Prism » ou « Upstream » lors de l’affaire Snowden, et l’exigence de respect du droit, en particulier du droit communautaire, laissent un peu perplexe. Faut-il reprocher aux Etats-Unis de mettre en place une politique de puissance ou regretter que la France ne prenne pas les mesures nécessaires pour assurer la sienne ?
On pourrait d’ailleurs s’amuser de l’incongruité de cette réaction tardive face à un système qui découle du Traité Ukusa, auquel ont souscrit les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume Uni et les Pays Bas depuis… 1946. Et, plus encore de cette référence à la nécessité d’une réaction européenne qui fut proclamée par les autorités françaises. Cinq pays européens sont en effet « associés » au Traité. Va-t-on, avec eux, créer un système européen véritablement indépendant de protection de données par un cryptage quantique (consortium SECOQ) ?
On pourrait plus encore s’amuser de voir que le rôle de la National Security Agency (NSA) est soudain mis en accusation pour son piratage économique connu depuis 1957 (cette agence a été créée dans le secret en 1952). L’institutionnalisation des écoutes économiques et politiques des puissances étrangères via, en particulier, le système dit « Echelon », a été autorisée aux yeux de tous par Jimmy Carter et son Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978, avant d’être développée, par Clinton, en 1994, avec le souci affiché de protéger les intérêts économiques de Washington.
Collecte d’informations, lutte contre la désinformation, contre la déstabilisation, pour développer l’ingénierie, le contre espionnage et lutter contre le terrorisme depuis 2001: voilà le projet officiel. Et ce projet indéniablement fait sens pour ceux qui veulent la puissance américaine, entre les attaques contre le centre d’Atlanta qui contrôle les drones en Afghanistan (2011) et celles de six banques américaines par des islamistes (2012), jusqu’au réseau Twitter (2013) : renforcer la puissance de ce pays était et reste un véritable enjeu.
Mais si leur comportement est compréhensible, et s’il convient de préciser que les Etats-Unis sont nos amis, il faut ajouter qu’ils sont aussi des concurrents et que les intérêts de ceux qui ont le souci de la puissance française ne concordent pas forcément avec ceux qui ont le souci de la puissance américaine. Les milliards de communications électroniques surveillées depuis l’Utah entrent dans cette guerre économique que se livrent les démocraties. Difficile pour la France, dés 1994, de ne pas songer à la perte du marché de 6 milliards de dollars par Airbus en Arabie Saoudite contre Mac Donell-Douglas ou de celle de Thomson-CSF face à Raytheon au Brésil, et cela en raison de l’espionnage numérique. Encore ne s’agit-il là que de ce que nous connaissons. Pourtant, malgré le rapport Martre, Intelligence économique et Stratégie des entreprises » de 1994, la France a curieusement poursuivi son somme. Et cela alors que, au nom de la lutte contre les pratiques déloyales et de la sécurité, les Etats-Unis développaient l’espionnage économique tous azimuts sous le contrôle d’une Cour de justice, le Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), dépendant du ministère de la Justice, qui ne s’en inquiétait pas. Par exemple, sur 1856 requêtes en 2012, elle n’en a rejeté… aucune. Il a fallu attendre 2003, l’affaire de la carte à puce de Gemplus, pour que la France sorte de ses illusions sur le bonheur de tous au pays du numérique. En particulier, à la suite du rapport de Bernard Carayon, Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale (rapport au premier ministre Jean-Pierre Raffarin, publié à la Documentation française, juin 2003), elle promit, mais un peu tard, qu’on ne l’y reprendrait plus. Mais sans pourtant prendre les mesures adaptées aux défis du temps.
La molle détermination française est d’autant plus étonnante que toutes les grandes puissances, dignes de ce nom, cherchent à développer leurs moyens d’intelligence économique, du satellite à l’extraction de données, le plus possible. Et elles aident leurs entreprises à obtenir des contrats et à pister les recherches des concurrents. Les 11 bureaux du ministère pour la Sécurité de l’État chinois ne se trompent pas sur les enjeux. Bien que venue tard sur cette sécurité numérique, elle a vu les avantages à en tirer en jouant l’intelligence économique. Elle en a fait une priorité, en particulier par le 4ème, 10ème et le 11ème bureaux. Et ses succès sont spectaculaires. Par exemple, beaucoup s’accordent à penser que les vols des données de l’agence de renseignement et de la Banque centrale d’Australie sont son œuvre, cela alors que le premier partenaire économique de l’Australie est la Chine. Tous les pays développés sont d’ailleurs des terrains de ce jeu chinois. La France se souvient de l’affaire Valeo en 2005. Et les Etats-Unis, en 2011, condamnèrent même Noshir Gowadia, pris la main dans le sac pour avoir donné à la Chine les technologies militaires liées au bombardier furtif.
En vérité, chacun, quand il le peut, agit de même. La Russie n’a pas même hésité à tenter de mettre à genoux l’Estonie, puis la Géorgie, par une cyber attaque d’Etat à Etat. Et même la Suisse investit en argent et en savoir, via son système Onyx, un «Echelon» miniature assez efficace au demeurant, pour préserver et pénétrer les secrets économiques.
La France a-t-elle pris la mesure de ces enjeux?
On peut en douter. Le Budget de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI) est de 80 millions d’euros dont 30 millions pour les salaires avec un objectif de 500 personnes en 2015. Soit sensiblement moins que le budget du Communications Electronics Security Group au Royaume Uni, et incommensurablement moins que le budget chinois, ou plus encore, américain, qui ne se restreint pas aux 1000 fonctionnaires du Department of Homeland Security comme certains commentateurs le croient mais qui concerne une part essentielle de l’activité de la NSA, dont le budget estimé est de plus de 10 milliards de dollars et compte environ 22 000 permanents.
Certes on peut se féliciter de l’augmentation du budget et du nombre d’employés de l’ANSSI, et compter dans les moyens de lutte contre l’espionnage économique d’autres secteurs d’activité non comptabilisés ici, tel le système satellitaire. Et le projet de reconnaissance satellitaire MUSIS, avec l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, la Grèce et l’Espagne permettra une plus grande performance en associant budgets et humains. Mais, on notera quand même que l’Italie et la Grèce sont aussi associés au Traité UKUSA et que la première puissance économique du globe, l’Union européenne, semble bien pusillanime face aux risques et aux menaces.
Plus encore, l’ANSSI ne manque pas seulement d’humains et de moyens, mais aussi d’autorité. Le politique ne l’a pas investi de pouvoirs contraignants.
Et les liaisons avec les centres de recherches universitaires et privés sont notablement insuffisants au regard de ce qui se passe aux Etats-Unis.
Elles sont tout autant insuffisantes avec des établissements publics tels que l’Institut National des Hautes Etudes de Sécurité et de Justice et le Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégique, eux-mêmes inadaptés, qui ne comportent, par exemple, aucun représentant du ministère des finances, de l’industrie, du commerce ou des télécommunications.
Ce qui démontre que la structure de la sécurité numérique à l’heure de la mondialisation n’a pas été introduite à la suite d’un benchmarking (Japon, Chine, Etats-Unis, Russie).
Cela est d’autant plus inquiétant que, loin d’échapper au fléau, de la cyber-criminalité, la France se classe au 16ème rang des pays où la cybercriminalité est la plus active. Et seulement au 8ème rang européen en termes de défense. Cyberterroristes, cybercriminels et hacktivistes ne sont, semble-t-il pas pris très au sérieux, malgré la publication du Livre Blanc « Sécurité et Défense 2013 » qui donne, certes, une place à la cyberdéfense mais sans les moyens, ni même la stratégie indispensables.
La France doit se réveiller. Le dernier rapport sur la cybercriminalité de la société américaine Symantec sonne d’ailleurs l’alarme de façon spectaculaire : le cybercrime est en expansion dans le monde et il paraît de plus en plus difficile de l’arrêter.
Et ce cybercrime est d’abord dirigé contre les Etats et ses infrastructures critiques, plus inquiétant et dévastateur que le terrorisme, parfois conjugué avec lui, au point d’avoir vu le Sénat des Etats-Unis en faire une question stratégique après l’attaque contre l’entreprise d’armement Lockeed Martin (2011). Croit-on que l’Atlantique ou les Alpes vont arrêter le nuage criminel en France ?
Cette nouvelle criminalité, l’actualité le confirme, vise ensuite le circuit financier et bancaire, clef de voûte du système économique. La dernière enquête du Ponemon Institute le dévoile : 64% des banques et entreprises du secteur financier américain ont subi des attaques l’an dernier. Une inquiétude grandissante, au point que leurs dirigeants s’attendent à une augmentation plus grande encore qui devrait dépasser 75%. Ce qui concerne jusqu’aux citoyens : la confiance dans notre système bancaire ne repose plus seulement sur la capacité des banques à investir correctement l’épargne des français mais désormais sur sa capacité à protéger les avoirs de ses clients.
Cette cybercriminalité vise, bien entendu, toutes les grandes entreprises. Ces actes ont déjà conduit à des pertes colossales touchant même des firmes qui semblaient pourtant disposer de protections avancées : Yahoo, Amazon, e-Bay, Google, la liste est longue. Et chacun a pu découvrir, en même temps, l’un des versants du « progrès » : un espionnage inconnu jusqu’alors, venant des entreprises concurrentes mais aussi des États, en particulier de certains émergents.
Plus grave peut-être encore : parmi les plus importantes victimes, les PME et les sous-traitants, avec 31% des attaques globales, soit une augmentation de 42% en 2012. Ce secteur, terreau de l’emploi et de la recherche, se croit trop souvent à l’abri. Il n’a pas encore vu clairement les enjeux de disposer de cadres possédant la maîtrise des risques réseaux numériques et il est ainsi devenu une cible de choix.
Les raisons de ce ciblage cybercriminel sont faciles à saisir. D’une part, ces PME sont moins protégées faute, de cadres compétents et de moyens adaptés, d’autre part, elles sont la porte d’entrée sur les grandes entreprises et les États, enfin, elles sont souvent porteuses de projets dynamiques dans la course aux brevets et à la novation.
Il est temps pour la France d’affronter courageusement le problème pour calculer les risques, prévenir les menaces et protéger, autant que possible, infrastructures vitales, entreprises et citoyens. Il est urgent de redéployer les moyens en interne autour de la seule compétence, ce qui nécessite de repenser toute la structure stratégique pour fédérer les savoirs et organiser l’action.
Il est temps aussi pour l’État d’associer à cette lutte toute la société civile. L’Etat doit donner l’inflexion et organiser la cohésion avec les opérateurs privés pour protéger ses infrastructures critiques et l’ensemble des entreprises, en particulier moyennes qui sont souvent le cheval de Troie pour pénétrer les grandes. Il faut inventer avec le patronat, les centres de recherche et les associations de vraies structures de coopération.
Cette volonté politique est le prix à payer pour protéger et développer la puissance de la France.
Yves Roucaute
La crise de l’industrie pharmaceutique est dangereuse pour la santé humaine
L’industrie pharmaceutique mondiale est en pleine crise. Et c’est d’autant plus grave que l’enjeu est stratégique : la santé humaine. Les groupes suisses Novartis et Roche ont supprimé 3000 emplois aux Etats-Unis l’an dernier, le laboratoire israélien TEVA, 5000, en deux ans.
Ces restructurations des entreprises pharmaceutiques correspondent à une situation très tendue sur le marché mondial du médicament à laquelle l’industrie française ne fait pas exception. Sa croissance s’est ralentie de 2003 à 2013, avant d’amorcer, depuis, un recul encore modeste, mais inquiétant : restructurations, comme celle du groupe Pierre Fabre, (entreprise patriotique par excellence, détenue par une fondation), réduction des coûts, licenciements, le LEEM – l’instance représentative des entreprises du médicament – a ainsi comptabilisé, en 2014, 27 plans de sauvegarde de l’emploi dans ce secteur, portant sur 3200 postes. Les entreprises ont décidé de se désengager petit à petit de la médecine de ville au profit des produits innovants destinés à l’hôpital, ou de rester sur la médecine de ville mais en se focalisant sur des niches de prescripteurs spécialisés, rhumatologues ou psychiatres. Plus inquiétant encore, les entreprises pharmaceutiques les plus importantes – les «Big Pharma» – renoncent aussi par paliers à leurs sites de production et même à la R&D.
Ce renoncement à la production et à la R&D n’est pas la stratégie pertinente : pour les «Big Pharma», il est évident que l’avenir est aux produits à très haute valeur ajoutée – biotechnologies, traitement des maladies rares, vaccins. Renoncer à la R&D apparaît donc absurde. Les entreprises de taille intermédiaire, plus souples que les «Big Pharma», sont mieux capables de s’adapter aux évolutions du marché français même si elles n’ont pas généralement les moyens d’investir dans la R&D de manière optimale. Le nombre de visiteurs médicaux a, certes, diminué de 7% par an, depuis dix ans. Cet effort drastique s’explique par des phénomènes contraignants, comme la prédominance des génériques sur le marché officinal et les déremboursements idoines, ou des obligations réglementaires nouvelles – transparence, prévention des conflits d’intérêt. Cette évolution se traduit par des systèmes «multi-canaux», où l’échange face-à-face du visiteur médical serait démultiplié par des échanges numériques en amont – le visiteur médical pouvant assurer des visites à distance ou dispenser des formations par Internet. En l’état, seule une catégorie particulière de visiteurs médicaux, les Attachés à la Promotion du Médicament (APM) créés en décembre 2009 peuvent assurer ces services. Mais ces services restent marginaux.
Il en est de même pour les opérations de «co-marketing», dans lesquelles des entreprises pharmaceutiques mutualisent leurs efforts dans le développement puis la vente d’un médicament. Les entreprises tendent en France à abandonner ces accords au profit de «co-promotions» ; un processus dangereux car si les coûts ainsi mutualisés sont moindres, l’approche globale de la chaîne de production et de vente du «co-marketing» fait défaut. Les entreprises risquent donc de perdre de vue le ciblage du produit sur le marché.
Même si des entreprises françaises ont compris les évolutions du marché sous l’effet des normes et ont engagé les stratégies adaptées, telles que le groupe tarnais Pierre Fabre, il est urgent que le gouvernement définisse une stratégie s’appuyant sur les tendances de ce secteur. Car si la France demeure le premier exportateur européen de médicaments, son industrie, fondée sur des fabrications d’entités chimiques classiques, est vieillissante et très absente des productions par biotechnologies. L’effort, de tous les gouvernements, de maîtrise des dépenses de santé porte pour l’essentiel sur une industrie dont le coût pour l’assurance-maladie n’est que de 15%. Ce n’est pas judicieux, c’est trop facile, et c’est injuste. Cette politique malthusienne pénalise la recherche, c’est-à-dire l’avenir. Un audit public, qui pourrait être engagé par les commissions des finances des deux assemblées, est indispensable pour comprendre les freins à l’investissement des «Big Pharma» dans la production et la R&D, dans le modèle «multi-canal» de la visite médicale et la marginalisation du «co-marketing». Après cet audit, les pouvoirs publics seront en mesure de dialoguer avec les entreprises et leur proposer un système incitatif. Il restera néanmoins la question des entreprises de taille intermédiaire, qui auraient, plus encore que les «Big Pharma», besoin d’un soutien, en dopant par exemple le crédit-impôt recherche, pour les encourager à investir dans la R&D, pari humaniste en faveur du bien le plus précieux des hommes : la santé.
BC
Sur le grand marché transatlantique… Un marché de dupes ?
Il n’est pas exagéré de qualifier de «dangereuses» les négociations commerciales qui se sont engagées depuis un an, entre l’Europe et les États-Unis.
Les États-Unis ont l’habitude, en effet, d’imposer à leurs partenaires des règles ou des contrats qu’ils contournent avec allégresse, mais qu’ils présentent comme autant de « progrès ».
Le « pays des libertés », individuelles et économiques, est aussi celui qui, depuis 20 ans, et en particulier depuis les attentats du 11 septembre, a construit un système d’espionnage inédit dans l’histoire du monde, comme l’a démontré l’agent Snowden. Et depuis le « Buy American Act », issu des années 30, les États-Unis se réservent l’essentiel de leurs marchés publics (70 %) quand les Européens l’ouvrent largement à leurs concurrents (90 %)..
Mais les négociateurs américains sont habiles :
– Ils promeuvent la disparition des droits de douane (4 à 5 %) alors que le dollar, au cours des 10 dernières années, a fluctué de 1 à 2.
– Ils soulignent la nécessité de normes et de standards communs, sujet qu’ils dominent depuis longtemps (on se souvient de la bataille perdue par l’Europe sur les normes comptables IFRS).
– Enfin ils vantent les procédures d’arbitrage au détriment des systèmes judiciaires locaux, ce qui est justifié lorsque le contentieux sont plaidés dans des pays faiblement développés, où les magistrats manquent d’expertise et d’indépendance, mais ce qui est beaucoup moins vrai en Europe où l’Etat de droit a un sens.
Face aux États-Unis, la Commission européenne…
Aux reproches d’opacité régulièrement soulignés, elle oppose le mandat reçu des Etats-membres et s’en remet à eux pour éclairer les opinions publiques. Les Etats, au terme de la négociation, ne pourront opposer de droit de veto et le Parlement européen ne pourra amender le Traité : il se prononcera pour ou contre le texte, dans une ambiance que l’on ne peut imaginer sereine… L’autonomie dans laquelle fonctionne la Commission – qui ne nous a pas habitué au réalisme – est inquiétante.
La France a l’expérience de réponses adaptées à ce type de situation : politique de la « chaise vide» par Charles de Gaulle, blocage des accords de Blair House par Alain Juppé, alors Premier ministre… Pour l’instant, la France se réjouit d’avoir « sorti » la Culture des négociations, au prétexte de son « exception ». C’est un peu déroutant, et, au passage, on observera que le « protectionnisme culturel » ne suscite aucun état d’âme chez les « observateurs », quand la seule exigence de réciprocité et la préférence communautaire reste des tabous à Bruxelles et les esprits français « éclairés »…
BC
N’hésitez pas à nous transmettre vos opinions sur le TAFTA !
contact@fondation–prometheus.org
Les terres rares, une menace en deux temps
Par Philippe Laurier, enseignant à l’Ecole Polytechnique, Cécile Bérillon, élève à l’Ecole Polytechnique (2012).

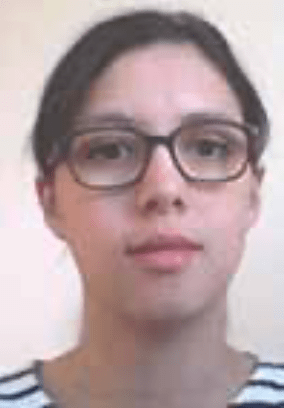
Il est d’usage de présenter la Chine comme exerçant un quasi-monopole de production de terres rares. Accusation vraie au regard d’un état des lieux instantané (anxiogène par médias interposés: « La Chine produit aujourd’hui 97% des terres rares »), mais fausse au regard de sa trajectoire («La Chine (…) deviendra un jour importatrice nette de ces matières » [1]).
Les pays autrefois producteurs, puis évincés par les bas coûts chinois, peuvent être regardés comme ayant conservé leurs réserves, tandis que la Chine puise dans les siennes et voit ses coûts salariaux croître. En raison d’une surexploitation, les ressources chinoises estimées seraient passées en quelques années de 40 à 23% des réserves mondiales. Pékin a annoncé devenir importateur net de terres rares lourdes en 2014 ou 2015.
L’électrochoc provoqué en 2010 par la prédominance minière chinoise a suscité le lancement de projets hors de Chine, ainsi que de réouverture de mines à l’instar de Mountain Pass en Californie. Le potentiel de cette dernière, un temps le plus gros centre productif mondial, reste énorme, au même titre que Mount Weld en Australie. Cette vague préfigure une relance de l’offre hors de Chine, avec des capitaux où la part anglo-saxonne est une clé pour la compréhension de la future donne.
La structuration d’une offre alternative à la Chine modifie mais ne supprime pas le risque
Le Commissariat à la stratégie et à la prospective estime que le marché des terres rares légères (quoique l’enjeu futur véritable concerne les terres rares lourdes) devrait, dans les prochaines années, se rapprocher d’une situation oligopolistique, et reconnaît que « le domaine des métaux critiques est moins une question de pénurie physique que de volatilité des prix et de difficultés ponctuelles d’approvisionnement » [2].
La future menace d’oligopole minier, et de spéculation sous influence, aura dans peu d’années, une probabilité d’occurrence plus élevée que n’en aura eue le spectre d’un embargo par la Chine. La France se trouve confrontée à une menace en deux temps : une raréfaction décrétée par la Chine, et un possible pacte, hors de Chine, entre acteurs miniers, du négoce et de la spéculation.
Le principe de stocks n’est pas réductible à un rôle anti-embargo, mais aidera à lisser les cours des matières premières, pour ne pas subir le court terme spéculatif. Plusieurs pays entrent dans l’ère des stocks stratégiques, soit des producteurs comme la Chine, soit des importateurs et dépendants tel que le Japon.
L’approche multifacette russe
En 2013, Arkadi Dvorkovitch, Vice-Premier Ministre, a déclaré son objectif de créer un fond pour disposer de réserves stratégiques sur le long terme (pétrole, gaz, uranium et terres rares). Les contenances des divers stocks sont secrètes.
Une institution d’Etat, le Gokhram, gère le Fonds National de Métaux précieux et Pierres précieuses de la Fédération de Russie, sous le contrôle du Ministère des Finances. Ce fond détient des réserves d’or, de métaux précieux (argent, platine, palladium) ainsi que de produits finis issus de ces matières. Cas d’école, durant la crise financière, Gokhram a acheté, pour plusieurs milliards de roubles, des diamants de producteurs russes pour leur permettre de continuer leurs activités, et a commencé à les revendre un an plus tard.
La Russie crée aussi des stocks sous forme de listes stratégiques de gisements de gaz ou terres rares non exploitables par des compagnies étrangères.
L’approche américaine : rebâtir un dispositif de stocks, assis sur une approche industrielle
L’attitude des décideurs américains est presque schizophrène, tiraillée entre, d’une part, des milieux financiers et miniers désireux de rentabilité et souvent hostiles au principe de stocks régulateurs, et d’autre part, des sphères militaires enclines à protéger les approvisionnements des industries sensibles. La voie médiane, actuellement empruntée, repose sur l’édification concomitante :
– à l’international, d’un contrôle puissant exercé de l’amont à l’aval de la filière, par des voies capitalistiques et diplomatiques ;
– en interne, d’une relance des capacités productives sur le sol américain, soutenue par la National Mining Association. Un projet de loi a été voté pour faciliter les demandes de permis d’exploitation et d’exploration, et assurer au pays les ressources nécessaires en matériaux stratégiques.
Les stocks constituent pour Washington un maillon bouclant cette stratégie. Le républicain Mike Coffman a décrit la Chine comme un partenaire commercial peu fiable, s’agissant des terres rares. Il préconise une chaîne d’approvisionnement compétitive aux Etats-Unis.
Les Etats-Unis maintiennent un stock de matières premières concentré sur les métaux indispensables à l’industrie de la défense : le National Defense Stockpile. En 2001, il contenait du béryllium, du germanium, du platine, du palladium, de l’aluminium, de l’argent, des diamants, etc.
En 2011, l’American Security Project thinktank a déclaré que le stockage était un des moyens de se préparer à toute pénurie de terres rares, avant que les capacités d’extraction et d’exploitation des Etats-Unis aient augmenté. Le Strategic and Critical Materials – 2013 Report on Stockpile Requirements recommande le stockage de terres rares lourdes pour une valeur de 120 millions de dollars. Rapport qui souligne combien l’enjeu portera sur les terres rares lourdes plus que pour l’ensemble des terres rares (Ainsi, le Projet Phoenix vise la production de terres rares lourdes à Mountain Pass).
1. Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Technologiques et Scientifiques, mars 2011 : « Les enjeux des métaux stratégiques : le cas des terres rares ».
2. Commissariat général à la stratégie et à la prospective : «Un enjeu pour la compétitivité des industries française et européenne ? ». Note n°3, juillet 2013
Intelligence économique et innovation
Mettre l’intelligence économique au service de l’innovation : tel est l’objectif visé par un groupe d’experts rassemblé autour de Christian Coutenceau, en publiant un ouvrage dédié à ce sujet aux éditions Eyrolles. Plus précisément, il s’agit d’aider les dirigeants de PME à mettre leurs entreprises en posture d’innovation permanente, en leur proposant des outils simples et directement opérationnels et en les sensibilisant aux apports de l’intelligence économique en matière d’innovation et d’aide à la décision. En s’appuyant sur l’expérience de ces experts, il s’agit in fine de contribuer à créer les emplois qualifiés et pérennes de la France de demain. Une question d’une brûlante actualité. Nous sommes ainsi allés à la rencontre de l’un des auteurs, Bruno Racouchot, spécialisé dans la mise en œuvre de stratégies de communication d’influence…
Cet ouvrage collectif se compose de 50 fiches pratiques. Quels objectifs poursuivez-vous ?
Avec notre équipe, nous avons développé nos réflexions autour de huit grands axes, pour répondre aux préoccupations concrètes des dirigeants d’entreprise et leur ouvrir de nouvelles perspectives. Nous leur proposons ainsi :
– D’innover en collaboration avec leur écosystème ;
– De construire des alliances pérennes tout en pilotant le patrimoine immatériel de l’entreprise ;
– De développer leur veille pour détecter les informations décisives avant les autres ;
– De protéger au mieux leurs actifs et ressources clés ;
– D’accroître leurs capacités de financement des innovations ;
– De transformer leurs organisations pour les rendre promptes à intégrer les changements ;
– D’être des acteurs d’influence en s’appuyant principalement sur leurs valeurs intrinsèques et sur l’identité de l’entreprise ;
– Sans oublier de développer l’attractivité de nos territoires, terreau de nos entreprises.
Pourquoi insister sur la dimension innovation ?
Innover constitue une exigence pour le dirigeant à l’heure où la concurrence se révèle être impitoyable au sein de marchés en recomposition permanente. Entreprises ou collectivités territoriales doivent ainsi concevoir des offres adaptées aux attentes des marchés, en optimisant leurs avantages concurrentiels. Dans ce cadre complexe, il est évident que l’on ne peut agir seul. D’où l’idée de favoriser la co-innovation. L’expérience a d’ailleurs prouvé que les entreprises qui savent gérer les échanges d’informations avec leur écosystème trouvent rapidement la voie du succès et s’adaptent aux nouveaux défis. Collaborer est devenu vital. Désormais, l’enjeu pour l’entreprise est de partager des informations et des savoir-faire sans se faire piller. C’est la raison pour laquelle elle doit avoir une vision claire du montage pratique des collaborations possibles et équilibrées entre partenaires. Ce qui implique tout à la fois de susciter la confiance, de développer le patrimoine immatériel de chacun et, le cas échéant de rayonner pour attirer de nouveaux partenaires.
Vous mettez l’accent sur les bouleversements incessants qui affectent notre environnement. Ils bouleversent selon vous notre vision du management ?
C’est indéniable. Les territoires comme les entreprises se trouvent directement ou indirectement soumis aux pressions de la concurrence mondiale. Il est donc impératif de mettre tout en œuvre pour attirer et conserver sur son territoire des entreprises performantes et productrices de valeur ajoutée, autour desquelles peuvent ensuite se développer des activités porteuses des emplois qualifiés de demain. Ce qui implique de renouer avec la stratégie (voir à ce sujet l’excellent ouvrage de Philippe Baumard, Le vide stratégique, éditions du CNRS, 2012) et de s’efforcer de penser sur le long terme.
Il faut également faire preuve de pragmatisme, ouvrir les yeux sur les réalités du monde, sans renoncer cependant à être ce que l’on est, donc en préservant son identité, comme l’a parfaitement mis en relief très récemment Hervé Juvin (La grande séparation, Gallimard, 2013).
Il appartient notamment aux territoires de fédérer toutes les ressources et compétences disponibles. D’où l’impérieuse nécessité d’exploiter les informations collectées et de capitaliser sur les opportunités en s’appuyant sur une méthode impliquant l’ensemble des parties prenantes. C’est ce que s’étaient efforcés de faire dès les années 2007/2008 Christian Coutenceau et son équipe en développant la méthode MADIE, méthode d’aide à la décision par l’intelligence économique (http:// madiecpa.free.fr/). Une telle posture, offensive et ouverte à l’endroit de son écosystème, transforme l’entreprise en hub, la rendant tout à la fois plus agile et apte à fédérer les énergies…
… ce qui a un impact sur notre conception du management…
Oui, naturellement. De manière très concrète, il s’agit de mettre l’entreprise en posture d’innovation tout à la fois permanente et durable. Comment ? D’abord en posant les bonnes questions. De quelle manière les dirigeants doivent-ils assumer leur leadership ? Comment mobiliser les collaborateurs autour d’une vision partagée ? Quels sont les chemins pour rétablir confiance et bien-être, au service d’une nouvelle forme d’efficacité et d’une approche apte à concilier hommes et systèmes ?…
Vous insistez tout particulièrement sur le fait qu’une identité forte constitue sur le plan communicationnel un atout compétitif majeur. C’est là selon vous une clé majeure de la communication d’influence, qui constitue une innovation essentielle à exploiter pour l’entreprise. Pourquoi ?
Pour rebondir sur la question du management que vous évoquiez, force est de constater que l’on trouve davantage de gestionnaires que d’entrepreneurs au sens propre du terme à la tête des structures publiques ou privées. Ce qui pose problème quand on sait que la question de l’innovation se rattache intrinsèquement au thème de l’identité.
– Identité personnelle d’abord. Seul un dirigeant qui a une solide assise mentale et culturelle et qui dispose d’une force de caractère peu commune est à même de conduire un processus d’innovation à son terme. Steve Jobs se réjouissait d’avoir beaucoup d’ennemis, car il savait que sa forte identité suscitait rancœurs, jalousies et incompréhension. Son mérite fut de transformer avec brio cette différence en préférence, puis en adhésion.
– Identité structurelle ensuite. De fait, il existe souvent un parallélisme entre l’identité du fondateur et celle de la structure qu’il a fondée. On le sait, une identité forte inscrit l’entreprise ou la marque dans la durée.
Or, il faut bien comprendre que l’identité n’est jamais figée. Elle est en perpétuel devenir. Le high end branding ou branding haut de gamme cher aux Anglo-saxons est là pour le prouver. Cette identité forte est en réalité la colonne vertébrale de la marque. Pour étayer cette argumentation, permettez-moi de citer quelques réflexions émises par des spécialistes et regroupées dans Les Cahiers de Friedland, n° 7, 2011, publiés à l’initiative de la consacrés Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Ce numéro était dédié au thème du Temps, variable stratégique de l’entreprise. Jean-Noël Kapferer, professeur à HEC Paris, notait ainsi que «le temps ne rend pas uniquement obsolètes les produits mais le système de valeurs de la marque. Il faut donc savoir se réinventer : garder son ADN mais jeter aux oubliettes des apports liés à l’histoire récente et aux contingences de marché.» Dans le même esprit, Jean-Louis Scaringella, directeur général adjoint de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, remarquait que «nous souffrons tous aujourd’hui de cette suprématie de l’urgence sur le temps de la réflexion, le temps du sens ou encore de la “réinvention”, alors que nous sommes en période de rupture».
Or, c’est bien d’une vision stratégique s’inscrivant dans le long terme dont nous avons besoin pour innover réellement, démarche volontaire en faveur de laquelle plaide l’économiste Jean-Paul Betbèze lorsqu’il dit : «Il nous faut absolument de grands desseins. Les petits projets donnent seulement le moyen d’aviver les luttes d’influence et de partage, pour la simple raison qu’ils donnent et donneront moins à partager, ayant un horizon plus court. Ce sont seulement la fresque, la projection dans le temps long qui permettent d’organiser les anticipations, de se mettre en ordre de bataille, d’avancer ensemble.» Innover, ce n’est donc pas seulement affaire de technique, c’est d’abord une question d’état d’esprit.
En guise de conclusion, comment faire pour retrouver le goût d’innover ?
Il nous faut avant tout faire preuve d’un autre état d’esprit. Comme je l’ai écrit dans la conclusion de l’ouvrage, nous devons refuser de subir, et à l’inverse, reprendre la main. Sachons d’une part observer le réel en passant par-dessus bord les filtres déformants des pensées convenues ; et d’autre part en finir avec cet absurde principe de précaution poussé à l’extrême, qui nous inhibe et finira par nous tuer. Enfin, réapprenons les vertus du temps long, rompons avec la tyrannie des chiffres et de l’immédiateté, bref extrayons-nous de l’omnipotence de la technique pour, à nouveau, faire jouer les forces de l’esprit!
Telles sont quelques-unes des règles fondamentales à observer et appliquer pour qu’une renaissance viable et crédible puisse être envisagée. En renouant avec la stratégie et le temps long, l’innovation s’impose comme un levier. Ce qui exige une prise de conscience. Car on se situe là à rebours des paradigmes actuels du monde contemporain. Donner ses lettres de noblesse à l’innovation, c’est d’abord revenir à l’étymologie du mot, lequel en latin signifie «renouveler». Penser l’innovation dans une perspective métahistorique, c’est d’abord en appeler à un renouvellement de la pensée, donc de la perception du monde et de la réflexion sur celui-ci. L’intelligence économique, c’est aussi l’intelligence des situations. Or, pour innover et trouver de nouvelles voies, il faut d’abord savoir qui l’on est (conscience de son identité), savoir où l’on va (dimension stratégique), avoir du courage (s’extraire de la pensée convenue) et de la ténacité (penser sur le long terme). Revenons-en donc à ces fondamentaux.
La France désarmée dans la mondialisation
Un rapport récent de la délégation parlementaire au renseignement décrit le pillage de l’économie française par l’espionnage. Le constat a été fait il y a dix ans déjà : dans la guerre économique, la France et l’Europe ne luttent pas à armes égales avec leurs concurrents. Pourtant, même si les efforts de l’ancienne majorité étaient insuffisants, les bases d’une politique ambitieuse en la matière ont été jetées pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy : création d’un fonds souverain, le FSI, doté de 20 milliards d’euros, emprunt de 35 milliards pour financer les investissements d’avenir, soutien aux filières industrielles, sauvetage des banques européennes dans la crise de 2008, mise en place d’une politique publique d’intelligence économique pour protéger nos entreprises et leur ouvrir les yeux sur la mondialisation, promotion de la réciprocité commerciale à laquelle la Commission européenne a toujours été rétive, par dogmatisme libéral.
Or, alors que les circonstances se prêtaient depuis deux ans à des évolutions majeures, quatre erreurs stratégiques ont été commises par les gouvernements de François Hollande. L’affaire Snowden, du nom de l’agent de la NSA qui a livré à l’opinion publique mondiale les secrets de l’espionnage américain, a apporté la preuve massive et concrète du programme inouï de renseignement politique, industriel et privé de notre « meilleur ami » américain. L’Europe et ses dirigeants nationaux, embarqués par les États-Unis dans un nouveau traité de libre-échange (le Tafta), avaient l’occasion historique d’un bras de fer avec le président Obama afin d’exiger le respect de l’intimité de nos dirigeants, de nos entreprises et des citoyens. François Hollande s’est contenté de réclamer des « explications » et le président Barroso de suggérer la création d’une « commission » ! Première erreur.
Le gouvernement veut protéger le secret des affaires. C’est honorable, même si les députés socialistes – à l’exception notable de Jean-Michel Boucheron – n’ont jamais marqué, dans le passé, le moindre intérêt pour ce sujet. Ainsi, l’exécutif n’a pas fait adopter par le Sénat, en majorité à gauche jusqu’à septembre dernier, ma proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires, adoptée par l’Assemblée sous la précédente législature. À l’époque, mon texte était pourtant soutenu par Jean-Jacques Urvoas (PS), actuel président de la commission des lois. En outre, à mon initiative, le Parlement avait permis aux entreprises françaises, confrontées aux exigences d’informations émanant d’autorités étrangères – en particulier à travers la fameuse et hallucinante procédure américaine de Discovery – d’obliger celles-ci à se conformer à la convention internationale de La Haye. Or, à l’occasion de l’examen à l’Assemblée de la loi Macron, la majorité actuelle va affaiblir cette protection. La gauche est sans doute soucieuse de ne brusquer ni le Quai d’Orsay, timide par nature, ni les Américains, qui ont rappelé brutalement à la BNP le respect de leurs règles. C’est une deuxième erreur.
Il fut un temps où le patriotisme économique était la trame d’un discours volontariste. Même si Arnaud Montebourg n’en était pas l’auteur, ce concept avait le mérite de démarquer notre politique économique du tout-marché et du tout-État. La puissance publique affirmait son souci de défendre nos intérêts dans le respect de la réciprocité avec nos partenaires. Or la marinière de l’ancien ministre du Redressement productif n’est pas le vêtement d’Emmanuel Macron. Il ne peut y avoir de patriotisme économique français si les Européens n’adoptent pas une approche continentale des questions industrielles et stratégiques. Et la France est trop faible politiquement et économiquement pour surmonter les réticences très libérales de l’Allemagne, et le dogmatisme des commissaires européens, en matière de concentration et d’aides publiques. Nicolas Sarkozy, en 2008, avait su et pu violer à la fois les textes européens et Manuel Barroso, alors président de la Commission européenne, en imposant un plan massif et public de consolidation desbanques. On n’en est plus là. C’est une troisième erreur.
Le rachat d’Alstom par General Electric pose la question lancinante de la propriété de nos fleurons industriels, tantôt rachetés puis démantelés, tantôt délocalisés pour des raisons fiscales. Le drame sidérurgique de Florange symbolise le renoncement de la gauche libérale à sa culture ouvrière et industrielle, alors que le rapport Gallois, commandé par le chef de l’État, soulignait que la « cote d’alerte » de l’industrie française était atteinte. La création de fonds de pension était la réponse à ce débat auquel le rachat, par un groupe chinois, de l’aéroport de Toulouse confère son actualité. La gauche pouvait accomplir ce que la droite n’avait osé accomplir. Ne pas l’avoir fait est une quatrième erreur.
Face à ces défis, la réponse de l’État est restée administrative, pour ne pas dire bureaucratique. Il est désolant que le seul conseil apporté par l’État et par le président de la commission des lois aux entreprises soit d’éviter de laisser traîner une clé USB ou de téléphoner avec son portable !
Bernard Carayon
On en parle
– Idée
L’ANSII (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), créée en 2009, rattachée au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, est l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information de l’État comme de la promotion des technologies nationales.
« Réservoir » de compétences au profit « notamment » des réseaux d’État, l’ANSII doit évoluer : il serait opportun, par exemple, qu’elle détache des experts auprès des Préfets de région, en particulier des Secrétaires régionaux de l’administration régionale (SGAR), placés sous leur autorité, et chargés, entre autres missions, de mettre en œuvre la politique nationale d’intelligence économique. Voilà une évolution qui serait appréciée des PME, principales victimes de la cybercriminalité.
BC
– Corruption : l’œil de l’OCDE Le dernier rapport de l’OCDE sur la corruption à l’international a été publié le 2 décembre. Il souligne la prédominance des grands groupes parmi les corrupteurs et les corrompus. Il insiste sur la dureté des sanctions pénales et financières. L’OCDE relève aussi la tendance des pays signataires de la convention de lutte contre la corruption à baisser la garde dans ce combat ; 42 affaires de corruption ont été bouclées en 2013 contre 78 en 2011. N’est-ce pas plutôt le signe d’une meilleure prise en compte par les grands groupes des questions éthiques ? On observera au passage que ces affaires concernent pour l’essentiel les Etats-Unis ; 128 sanctions ont été prononcées sur leur sol, contre 26 en Allemagne, 11 en Corée et 6 en Italie. L’arroseur arrosé ?
– Mistral perdant ?
Le 25 novembre, le Président de la République François Hollande a décidé de repousser l’exportation d’un premier Mistral à la Russie. Quelles que soient les raisons diplomatiques invoquées – la question de l’Ukraine – cette décision entraîne de lourdes conséquences :
– industrielles : c’est l’avenir de DCNS qui en jeu, avec potentiellement 240 millions d’euros de pénalités – bien plus que son résultat opérationnel de l’année dernière (166 millions d’euros) ;
– commerciales : nos concurrents ont beau jeu de souligner auprès de nos clients et prospects la fragilité de la parole française ;
– légales : les indemnités risquent de s’appliquer, pour la simple raison que les Russes peuvent démontrer que ces navires sont déjà leur bien – une partie de leur conception étant russe.
– Cyberdéfense : les failles françaises
Le 10 octobre, un rapport parlementaire de Geneviève Gosselin-Fleury (SRC) et de Philippe Vitel (UMP) a rappelé les failles de la cyberdéfense française. Ils dénoncent notamment le recours par les services régaliens de l’Etat à du matériel informatique étranger. Les auteurs veulent s’assurer qu’une partie de l’effort – très significatif (1 milliard d’euros) – consacré à la cyberdéfense par la Loi de Programmation Militaire 2014-2019 servira à la relance d’une production nationale de ces matériels, prévenant le risque de dépendance et d’espionnage.

Laisser un commentaire